Les préférences alimentaires
Dans les « sociétés de consommation » les individus bénéficient d’un choix alimentaire considérable. Comment s’exerce ce choix ? Pourquoi tel aliment est-il trouvé appétissant et tel autre non ? L’appétence pour un aliment met en jeu plusieurs fonctions sensorielles.
Les papilles gustatives de la langue permettent de distinguer quatre familles de saveurs : le sucré, le salé, l’acide et l’amer. Mais les sensations gustatives sont infiniment plus variées. S’y ajoutent des informations olfactives : odeur ou parfum véhiculés par l’air inspiré, arômes des composés volatils remontant par l’arrière gorge dans les fosses nasales.
Ces données physiologiques sont complétées par des habitudes individuelles souvent liées à des données culturelles ou religieuses : les préférences d’un citadin New-yorkais n’ont pas grand chose en commun avec un habitant de Shanghai.
Les industriels se sont donc attachés depuis plusieurs décennies à privilégier un de ces aspects essentiels pour la consommation alimentaire qu’est le goût en utilisant des additifs alimentaires : les arômes, naturels ou synthétiques.
Estimé à 4,8 milliards de dollars US en 1997, le marché des arômes ne cesse d’augmenter. De façon générale, ceux-ci proviennent actuellement de l’agriculture et de la synthèse chimique. Depuis longtemps source privilégiée des arômes naturels, les végétaux les produisent sous forme d’huiles essentielles, de jus de fruits ou encore d’extraits de plantes. Cependant, on ne trouve le composé sensoriel actif qu’en quantités infimes ou encore dans une forme liée, ce qui rend sa purification difficile. Ainsi, il faut cinq millions de fleurs de jasmin pour produire un kilogramme d’extrait aromatisant de la plante ! Ceux qui utilisent les arômes naturels savent également combien aléatoire peut être l’approvisionnement en matières premières. En effet, les rendements en plantes aromatiques dépendent des conditions climatiques de plus en plus fluctuantes, des maladies, des parasites et même de l’instabilité politique de certains pays tropicaux et subtropicaux. Tous ces facteurs ne peuvent que contribuer à rendre le prix des arômes naturels prohibitif.
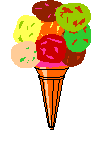
La synthèse chimique a si bien pallié les difficultés rencontrées avec les plantes que la majorité des arômes disponibles sur le marché sont aujourd’hui synthétique. En 1989, déjà 84 % des arômes commercialisés provenaient de la voie chimique. Les procédés de synthèse comportent des avantages certains, notamment une maîtrise assurée et des rendements nettement plus élevés. Ils contribuent donc à faire chuter le prix des arômes. A titre d’exemple, un extrait naturel de d-décalactone, une note aromatique de pêche, se détaille à 8525 dollars le kilogramme, alors que son équivalent synthétique se détaille à 202 dollars.
Dans certains cas, le résultat de la synthèse chimique n’offre pas la subtilité de goût que procure l’arôme naturel. De plus, la préférence des consommateurs s’est confirmée ces dernières années pour les produits naturels, c’est pourquoi l’utilisation et l’extraction d’arômes se sont beaucoup développées depuis quelques années.
![]() Retour
à l'industrie des arômes .
Suite
Retour
à l'industrie des arômes .
Suite ![]()